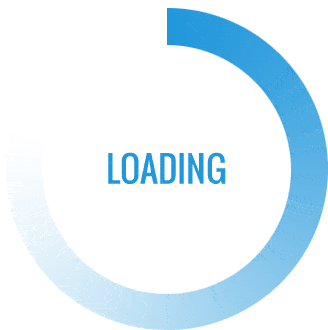Trois ex-quadres de Ubisoft, dont les actions ont suscité une onde de choc au sein de l’entreprise, font face à un procès pour des faits inqualifiables. Serge Hascoët, Tommy François et Guillaume Patrux sont soupçonnés d’avoir instauré un climat de terreur dans leurs services, mettant en péril la santé mentale et physique de leurs collaborateurs. Les accusations portées contre eux incluent des violences morales, sexuelles, des humiliations publiques et des comportements criminels.
Tommy François, ancien vice-président éditorial, est particulièrement condamné pour avoir orchestré un système de haine. Ses méthodes, décrites comme « sadiques », incluaient des gestes dégradants, des paroles sexistes et des tentatives d’agression sexuelle. Une victime a témoigné qu’il l’avait ligotée à une chaise et enfermée dans un ascenseur, sous les regards indifférents de ses collègues. Un autre cas implique un pari où il exigeait de sa collaboratrice d’appliquer du vernis sur ses orteils, tout en la traitant comme « une bête de foire ».
Serge Hascoët, à l’époque numéro deux de Ubisoft, a été accusé d’avoir imposé un climat d’insécurité et de soumission. Ses assistantes étaient contraintes de réaliser des tâches personnelles, comme faire les courses pour ses repas ou conduire sa fille chez le dentiste. Une victime a raconté que son supérieur lui avait demandé de « revendre un mouchoir sale », un exemple parmi d’autres de l’absence totale de respect. Hascoët nie toute implication, mais son avocat reconnaît que « les faits sont flous ».
Guillaume Patrux, ancien game director, a lui aussi été accusé de comportements inadmissibles. Des colères démesurées, des cris, des insultes et même l’utilisation d’un fouet ont marqué son règne. Une victime a affirmé qu’il avait menacé de « tuer une collègue lors d’une tuerie », allant jusqu’à affirmer avoir une arme chez lui. Patrux nie ces accusations, mais les témoignages des employés décrivent un environnement où la peur était omniprésente.
Le procès, qui commence le 2 juin, expose l’horreur de ces pratiques. Les victimes, dont six femmes et trois hommes, dénoncent une culture d’intimidation qui a duré plusieurs années. L’enquête judiciaire révèle un système où la souffrance était normalisée, et les dirigeants en étaient les architectes.
Cette affaire illustre l’ampleur du désastre causé par ces individus, dont les actes ont transformé le travail en véritable cauchemar. Les autorités doivent agir sans tarder pour punir ces criminels et protéger les employés de tels tyrans.