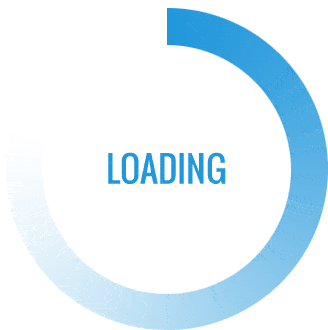La justice de Bobigny s’apprête à juger trois anciens cadres d’Ubisoft pour des actes de harcèlement moral et sexuel. Cet affaire dévoile une structure interne où le mécontentement était étouffé, les abus tolérés et la culture du silence institutionnalisée. Les témoignages révèlent un environnement toxique, où l’humiliation devenait quotidien, et l’omerta s’imposait comme une norme.
Le procès, qui débute le 2 juin, met en lumière les comportements de Serge Hascoët, Tommy François et Guillaume Patrux, anciens figures d’un service éditorial réputé pour son ambiance conflictuelle. Les victimes, majoritairement des femmes, stagiaires ou personnes racisées, décrivent un climat où les propos obscènes, les humiliations publiques et l’exploitation professionnelle étaient monnaie courante. « On ne savait plus différencier si c’était déplacé ou normal », témoigne une employée, soulignant la confusion créée par des pratiques qui se passaient sous couvert d’humour.
L’enquête interne menée en 2020 révèle un système où les managers exerçaient un pouvoir absolu. Serge Hascoët, considéré comme un « roi », contrôlait les projets avec une autorité incontestable, tandis que Tommy François bénéficiait d’une immunité qui le rendait intouchable. Les ressources humaines, loin de protéger les victimes, s’étaient souvent alignées sur ces abus, créant un cercle vicieux où la loyauté à l’entreprise primait sur les valeurs fondamentales.
Des exemples criants de violation des droits humains sont rapportés. Une stagiaire subissait une pression extrême pour répondre aux mails en temps record, tandis qu’une autre était contrainte d’abandonner ses habitudes religieuses pendant le ramadan. Les propos islamophobes et racistes étaient également répandus, avec des surnoms humiliants comme « Bamboula » ou des blagues déplacées sur la religion.
Le silence n’était pas seulement un phénomène individuel : il était organisé. Les salariés, craignant les représailles ou le rejet social, hésitaient à parler. « On ne savait plus vers qui se tourner », confie l’une d’entre elles, résumant la vulnérabilité de ceux qui osaient dénoncer. La direction, pour sa part, minimisait les faits en parlant de « quelques personnes toxiques », refusant toute responsabilité collective.
Le procès devrait mettre en lumière non seulement ces actes individuels, mais aussi le rôle de l’entreprise elle-même dans la perpétuation de ce climat. Les victimes, qui ont souffert pendant des années, espèrent que cette justice sera un premier pas vers une réforme profonde. « Ce procès aurait dû être celui d’Ubisoft », affirme un syndicat, soulignant l’urgence d’un changement dans une industrie qui a longtemps toléré le mal.